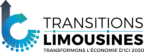Le dimanche 6 avril 2025, Transitions Limousines a participé à une journée d’initiation à la régénération des rivières aux Fermes de Ségur, en Corrèze.
Au programme : une immersion dans les techniques castors-mimétiques, une approche low-tech venue tout droit de Californie, imaginée par Kevin Swift et récemment introduite en France par Suzanne Husky et Baptiste Morizot dans leur livre Rendre l’eau à la terre.
Cette initiative repose sur un constat clair et préoccupant : plus de la moitié des rivières françaises sont en mauvais état écologique.
La dégradation est telle, et si ancienne, que nous avons hérité aujourd’hui d’une véritable amnésie de ce qu’est une rivière en bonne santé. Pour beaucoup, une rivière se résume à ce trait bleu, droit et discipliné, qui file vers la mer sur une carte. Une vision de canalisation : un cours d’eau «propre», sans embâcles, aux berges abruptes, se creusant toujours plus verticalement.
Mais cette vision est trompeuse.
Une rivière vivante, c’est tout autre chose : un réseau complexe de chenaux dynamiques, en constante évolution, qui s’accélère, qui ralentit, qui dépose, qui érode, rechargeant les nappes, créant des zones humides diversifiées en son lit, et soutenant une biodiversité vertigineuse.
Pourquoi mimer le castor ?
Parce que, quel que soit son état, une rivière a naturellement tendance à s’inciser : son lit se creuse, elle se déconnecte de sa nappe d’accompagnement et de ses chenaux secondaires, perdant en résilience face aux sécheresses météorologiques, aggravant les sécheresses hydriques.
Deux mécanismes naturels permettent de contrecarrer cela :
- La création d’embâcles (accumulation de branches, sédiments, etc. déplacés lors des crues) qui ralentissent l’eau,
- et… le castor, ingénieur hydrologue de génie, qui élève le niveau d’eau pour sécuriser ses déplacements et cultiver ses ressources alimentaires, créant au passage une multitude d’habitats favorables à toute une chaîne du vivant.
Les barrages de castors augmentent le temps de résidence de l’eau, ce qui permet :
- de reconnecter la rivière à ses chenaux secondaires et à sa nappe d’accompagnement,
- de ralentir l’eau et d’augmenter son temps de résidence,
- de rehausser le lit du cours d’eau en recrutant des sédiments,
- d’augmenter la résilience face aux inondations et aux sécheresses,
- de recréer une multitudes d’habitats fonctionnels et complexes,
- et d’enclencher une régénération active de la rivière vers son état d’origine.

Malheureusement, le castor a été décimé en France pour sa fourrure et pour le drainage des cours d’eau afin de récupérer plus de terres fertiles, et son retour reste timide.
C’est là qu’interviennent les techniques castors-mimétiques : des humains, inspirés par cette forme de vie fascinante, reproduisent ses gestes là où il n’est pas encore revenu ou suffisamment présent.
L’objectif : régénérer les rivières en faisant alliance avec le meilleur ingénieur hydrologue qui soit.
Apprendre à lire une rivière, dialoguer avec elle plutôt que la contraindre, en s’appuyant sur des procédés low-tech à taille humaine. Se réapproprier la question de l’eau.
Une journée entre paroles et pratique
La journée a commencé par une conférence avec Kate Lundquist, Kevin Swift et Suzanne Husky pour découvrir l’histoire et la philosophie de ces pratiques, avant de passer à la pratique l’après-midi.
Une quinzaine de participant·es venu·es de tous horizons (paysan·nes, technicien·nes rivières, citoyen·nes curieux·ses) ont appris à lire la rivière et à repérer les lieux les plus propices à accueillir un ouvrage castor.
Deux rus agricoles, fortement incisés suite à un drainage intensif en amont, ont pu ainsi entamer un processus de régénération grâce à nos apprentis castors à deux pattes.
Avant toute chose, les consignes de sécurité sont données, d’abord pour le vivant non humain (ou « plus qu’humain » comme aime à le rappeler Kevin), puis pour les humains.
Naturalistes et écologues inspectent la zone en amont et identifient les zones sensibles (nidifications, espèces protégées, etc.) pour adapter les interventions et limiter les impacts.
Ensuite vient le temps de « lire » la rivière pour définir l’emplacement des ouvrages.
La construction suit une logique simple mais subtile. Deux éléments sont essentiels à la réalisation de ces infrastructures, du « vert », de la matière végétale utilisée par le castor pour ralentir l’eau et créer une matrice recrutant le sédiment transporté par la rivière ainsi que de la terre, récupérée en amont de l’ouvrage pour venir enrichir cette matrice végétale.
La tâche n’est pas si simple, le castor fait avec ce qu’il trouve à portée immédiate de son ouvrage, il faut donc trouver le végétal adéquat et facilement recrutable, positionner le branchage d’une manière très spécifique toujours dans une optique de faire avec les forces de la rivière plutôt que de lutter contre :
- on empile les couches de vert et de terre, comme une lasagne, pour faire monter le niveau du ru de 40 à 80 cm (comme l’aurait fait un castor !) ;
- le tout est recouvert de « brun » (bois mort), placé de façon à rediriger l’eau vers sans éroder la crête de l’ouvrage.
Une fois le premier barrage en place, d’autres sont construits en amont et en aval pour reproduire différents effets hydrauliques et relancer les processus naturels de la rivière.
Et là, la magie opère.
Ce qui est fabuleux à lors de ces travaux, c’est ce sentiment de joie partagée par chacun, quelque soit l’âge, se prendre pour un castor et prendre soin de la rivière les mains dans la boue rend heureux. C’est le sourire aux lèvres que chaque participant voit avec une rapidité déconcertante l’impact positif de ces actions dans le ru, le niveau montant en même temps que la lasagne se monte.

Les premiers effets sont … immédiats !
16h00 : Fin des travaux
16h03 : Plouf !
Un campagnol amphibie, espèce rare et menacée, vient inspecter les ouvrages.
Des abeilles viennent s’abreuver sur les vasières fraîchement créées, et les insectes commencent déjà à pondre dans les micro-habitats spontanés.
Ce n’est que le début. Sur les sites plus anciens, on observe déjà des résultats spectaculaires année après année !
Poissons, libellules, oiseaux, etc. coloniseront vite chaque habitat proposé, apportant à la fois beaucoup d’espoir et aussi un peu de peur face à cette amnésie des milieux rivières.
Une action humble, joyeuse et puissante
Cette journée a semé un mélange d’effervescence, d’envie et de pouvoir d’agir.
Elle a aussi apporté une certaine sérénité, en montrant qu’il est possible d’agir à notre échelle, avec peu de moyens, en coopération avec le vivant et en produisant des effets spectaculaires et rapides. Reprendre possession de la question de l’eau comme bien commun, faire avec le vivant, prendre soin de la terre et de l’eau.
Un immense merci à Kevin Swift et Kate Lundquist pour leur venue depuis la Californie, à Suzanne Husky, à toute l’équipe du MPACA, et aux Fermes de Ségur pour leur accueil chaleureux.