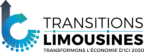Pour cette nouvelle collaboration avec le journal bas-marchois Mefia Te !, retour sur la pratique d’auto-production des jardiniers.
Le jardinage est souvent présenté comme un loisir, pourtant, l’auto-production de légumes, de fruits et des petits élevages contribue significativement à l’offre alimentaire. Il n’y a pas de statistiques pour le Limousin sur ces pratiques, mais des études nationales[1] récentes éclairent leur ampleur et montrent un fort développement. Voyons plus précisément ce qu’il en est et pourquoi cela mérite qu’on s’y intéresse.
Les résultats de ces études montrent que 60 % des Français ont au moins un jardin, un potager ou un verger, 33 % des Français possèdent un potager. Cela représente 1,2 million d’hectares de potagers et 1,5 million d’hectares de vergers. Au total environ 32 millions de personnes en 2024 ont une activité d’autoproduction, 16,6 millions fabriquent des conserves et 4,2 millions élèvent des poules. Près de 30% des autoproducteurs s’alimentent quasi-exclusivement avec les fruits et légumes de leur production, avec 282 millions de conserves par an (26 bocaux par producteur). On estime que 5% des français ne mangent que des œufs de leur propre poulailler.

Jardin de Joseph Chauffrey, jardinier urbain et formateur, auteur de « Mon petit jardin en permaculture » – https://josephchauffrey.fr/
Les motivations sont variées, mais elles portent d’abord sur le souhait de manger des légumes qui ont du goût, sains et naturels (55%), viennent ensuite des envies liées au bien être et à la reconnexion à la nature (36%). Les raisons économiques sont vues avec une importance moindre mais croissante dans les dernières années (38%, +8 points en 2 ans). Une très grande majorité des pratiquants déclarent y trouver du plaisir (64%) et une fierté (41%), ils sont aussi beaucoup plus satisfaits de leur vie à 62%.
En moyenne, 200€ sont consacrés à ces activités par an. Environ 43% des auto-producteurs estiment réaliser des économies, difficiles à quantifier, grâce à leur production, ce qui représente tout de même 21% des français. Ces activités d’auto-production jouent donc probablement des rôles d’amortisseur économique sous-estimés. Les jardiniers choisissent les espèces en fonction de leurs préférences gustatives et de la facilité de culture. Les tomates sont les plus populaires, suivies par les herbes, les fraises, les laitues et les courgettes. La plupart des jardiniers cultivent plusieurs espèces.
Ces pratiques sont en générales acquises par transmission familiale et en faisant soi-même ses propres expériences, ou en interaction avec d’autres jardiniers. Le jardinage revêt ainsi une forte dimension sociale, favorisant les liens entre générations et entre les personnes. Les dons de produits, les échanges de semences et plants sont des pratiques très fréquentes et reconnues comme étant importantes. Si les jardins restent majoritairement associés à la maison individuelle (94%), il y a une hausse régulière des jardins partagés et urbains qui participent fortement à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Mais 34% des français déclarent n’avoir accès à aucun espace vert privé ou partagé. On estime que 82% des potagers font 100m² ou moins ; les jardiniers les plus expérimentés ont en général de plus grands jardins. Si le niveau de la production est un critère objectif de réussite de la pratique, elle n’est pas vue comme devant être atteinte à tout prix et sans considération pour l’environnement. Cette préoccupation environnementale est à mettre en regard du fait qu’une faible part des auto-producteurs dépendent complètement de leur production, contrairement à ce qui pouvait s’observer dans le passé. Dans leur grande majorité (66%) les auto-producteurs utilisent des produits ou des pratiques respectueuses de l’environnement (compostage), ils implantent des végétaux favorables à la biodiversité, limitent leur consommation d’eau, utilisent des variétés rustiques. Cependant, il y a encore 11% d’auto-producteurs qui déclarent ne pas vouloir se passer des pesticides de synthèse, alors que la loi Labbé de 2014 l’interdit. La lutte contre les maladies et les parasites reste la principale difficulté rencontrée par les jardiniers, avec de plus en plus souvent les effets des aléas climatiques.
Pour de nombreux nouveaux jardiniers, cette activité s’inscrit dans une démarche de transition écologique à taille humaine, pour re-créer du lien avec le vivant et mieux comprendre ses liens avec notre alimentation. Le jardin a souvent une vertu symbolique et éducative. Il devient ainsi un lieu qui se fait visiter et dans lequel toute la famille peut passer du temps. Environ 13% des jardiniers sont considérés comme « engagés » pour une démarche environnementale dans laquelle le jardin et ses productions tiennent une place importante.
Toutes les études convergent pour souligner le développement rapide des pratiques d’auto-production et de jardinage, 17% des personnes déclarent vouloir augmenter leur surface cultivée. Les crises économiques, les enjeux environnementaux et les préoccupations de santé concourent aussi à inciter de plus en plus de personnes, quand cela leur est possible, à démarrer ou renforcer des pratiques de jardinage et de production alimentaire.
En effet, entretenir un potager améliore la santé globale non seulement par une meilleure nutrition, mais aussi en favorisant un bien-être psychologique profond. Outre l’encouragement à une alimentation plus riche en fruits et légumes frais, jardiner stimule une activité physique modérée régulière essentielle pour prévenir des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers, et le diabète de type 2. Le jardinage augmente aussi l’exposition à la lumière naturelle, favorisant la synthèse de vitamine D, qui joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système immunitaire, la santé osseuse et la prévention de certaines dépressions saisonnières. Gratter le sol permet aussi de rencontrer nombres de microorganismes bénéfiques à la santé humaine (attention tout de même à être à jour de sa vaccination antitétanique). C’est le cas de Mycobacterium vaccae qui soutient la régulation immunitaire et est impliquée dans le production de sérotonine, favorisant ainsi une humeur positive. Ce contact avec la terre diversifie le microbiote humain par exemple avec des actinobactéries, qui limitent la prolifération de pathogènes par une production naturelle d’antibiotique, et qui aident à la régulation de l’inflammation intestinale.
A Bellac, le jardin du lien[2] offre la possibilité de cultiver gratuitement des parcelles dans un jardin partagé où se déroulent de nombreuses activités. Il existe d’autres initiatives similaires en Limousin, et notamment à Limoges, mais il n’y a pas pour le moment d’annuaire qui les recense. Le bouche à oreille et les mairies restent les meilleurs façon d’en trouver un près de chez vous.
Dans un territoire majoritairement rural comme le limousin et la basse-marche, les jardins sont très fréquents et doivent probablement représenter une activité significative de production alimentaire. Elle pourrait être estimée en comparant les quantités achetées dans le commerce entre des secteurs ruraux et urbains, mais ce travail reste à faire. En attendant, créer et entretenir un potager est une approche globale pour améliorer la santé physique, mentale et immunitaire, en tirant parti de l’alimentation saine, d’une activité physique régulière, du contact avec la nature et de l’exposition à des micro-organismes bénéfiques.
Un article de Marc D., adhérent à Transitions Limousines
[1] https://www.bellac.fr/wp-content/uploads/2023/04/affiche-jardin-partage2023.pdf
[2] En 2021, une étude de la SEMAE a interrogé 1002 personnes sur leurs pratiques de jardinage et une étude réalisée par Gamm Vert en 2022 portait sur 4000 personnes. Un observatoire de l’autoproduction a été lancé dans la foulée de ces études. Les entreprises du paysage proposent aussi un baromètre Ifop-Unep des relations des français avec leur jardin
Bibliographie (SP)
1. Johnson JL, Kamya RM, Okwera A, Loughlin A, Nyole S, Hom DL, et al. Randomized Controlled Trial of Mycobacterium vaccae Immunotherapy in Non-Human Immunodeficiency Virus-Infected Ugandan Adults with Newly Diagnosed Pulmonary Tuberculosis. The Journal of Infectious Diseases. 2000;181:1304-1312. doi:10.1086/315393.
2. Bruyn G, Garner P. Mycobacterium vaccae immunotherapy for treating tuberculosis. The Cochrane database of systematic reviews. 2003;1:CD001166. doi:10.1002/14651858.CD001166.
3. Yazi D, Akkoç T, Ozdemir C, Yesil O, Aydogan M, Sancak R, et al. Long-term modulatory effect of Mycobacterium vaccae treatment on histopathologic changes in a murine model of asthma. Annals of allergy, asthma & immunology. 2007;98:573-579. doi:10.1016/S1081-1206(10)60738-7.
4. Zuany‐Amorim C, Manlius C, Trifilieff A, Brunet L, Rook G, Bowen G, et al. Long-Term Protective and Antigen-Specific Effect of Heat-Killed Mycobacterium vaccae in a Murine Model of Allergic Pulmonary Inflammation. The Journal of Immunology. 2002;169:1492-1499. doi:10.4049/jimmunol.169.3.1492.
5. Frank MG, Fonken LK, Dolzani SD, Annis JL, Siebler PH, Schmidt D, et al. Immunization with Mycobacterium vaccae induces an anti-inflammatory milieu in the CNS: Attenuation of stress-induced microglial priming, alarmins and anxiety-like behavior. Brain, Behavior, and Immunity. 2018;73:352-363. doi:10.1016/j.bbi.2018.05.020.
6. Loupy K, Lee T, Zambrano CA, Elsayed AI, D’Angelo H, Fonken L, et al. Alzheimer’s Disease: Protective Effects of Mycobacterium vaccae, a Soil-Derived Mycobacterium with Anti-Inflammatory and Anti-Tubercular Properties, on the Proteomic Profiles of Plasma and Cerebrospinal Fluid in Rats. Journal of Alzheimer’s Disease. 2020. doi:10.3233/JAD-200568.
7. Frileux, P. (2018). An Agroecological Revolution at the Potager du Roi (Versailles). In: Glatron, S., Granchamp, L. (eds) The Urban Garden City . Cities and Nature. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72733-2_6
8. Activité physique et santé [Internet]. Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités; 2023 [cited 2024 Mar 30]. Available from: https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante